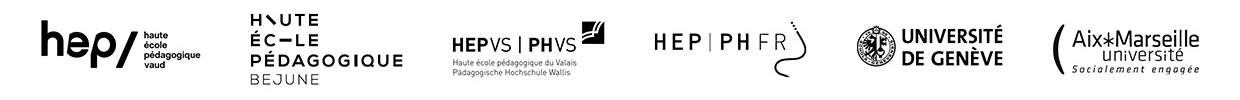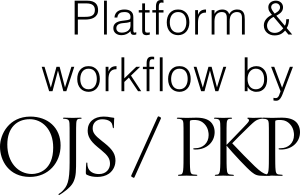Archives
-

Arts plastiques et théâtre dans les enseignements et la recherche : quelles approches et quelles perspectives pour l'école de demain
No. 5 (2025)Ce 5e numéro de la revue Journal de recherche en éducations artistiques / Journal of Research in Arts Education s'inscrit dans une dynamique interdisciplinaire et transdisciplinaire à documenter, inventer ou réinventer. Il s'agit ici d’interroger la place du sensible en éducation comme socle de compétences transversales liées aux processus d’enseignements et d’apprentissages. Ce trait d’union est constitutif de l’entre (Jullien, 2011) à partir duquel peut émerger une « esthétique relationnelle » (Bourriaud, 1998) entre l’enseignant·e et l’élève, les participant·e·s et le/la chercheur·se, le créateur/la créatrice et le milieu, les différents arts, les arts et d’autres disciplines, entre l’intelligible et le sensible, etc. À la croisée des arts plastiques et du théâtre, des fine arts et des performing arts, la relation complexe soi-autre(s)-environnement(s) façonne les approches méthodologiques en didactique et en recherche tout comme elle participe aux processus cognitifs. Quels modèles éducationnels sensibles sont proposés dans le monde ? En quoi ces nouveaux modèles performatifs invitent-ils à reconsidérer la place donnée aux savoirs savants, aux savoirs experts, aux modèles académiques, aux pratiques sociales de référence ou aux questions socialement vives dans les différents systèmes éducatifs ?
-

La place du corps dans l'éducation à la création artistique: quels enjeux ?
No. 4 (2024)Ce numéro 4 JREA/JRAE fait suite à la journée d’étude organisée à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) du 6 juin 2023. Elle portait sur les enjeux autour de la place du corps dans l’éducation à la création artistique. Avec ce numéro, nous souhaitons publier des articles en lien avec cette thématique.
Tandis que le verbe « transmettre » s’incarne en didactique de la danse, du fait même qu’il renvoie à « mettre dans le corps de l’autre » (Mili et al., 2013, p. 92), la proposition consiste à interroger cette conception de la transmission en l’élargissant aux autres disciplines artistiques dans leur diversité (arts visuels, musique, activités créatrices et manuelles, design, arts performatifs, etc.).
Au cours du XXᵉ siècle, l’éducation artistique a évolué, d’une approche centrée sur le produit fini et la maîtrise technique à une approche portée sur le processus (Lahalle et Lagoutte, 2006) en tant que « faire » artistique, dont l’essence même se rapproche d’un cheminement entre réflexion et pratique (Pélissier, 1998). Dans cette perspective, ce numéro spécial tend à définir l’étroite relation entretenue entre processus d’incorporation du savoir et processus de création dans l’éducation en art. Nous y interrogerons les notions de corporéité, de corps propre, d’incorporation et d’incarnation (embodiment) lors d’une démarche de création en contexte de formation.
En éducation, bien que le corps devienne central dès le début du XXᵉ siècle, avec l’émergence des pédagogies dites actives (Jaques-Dalcroze, Montessori, Kodály, Willems, Orff, Freinet, etc.), Pujade-Renaud (2005) expose une toute autre réalité en contexte de formation. Celle-ci se cristallise dans l’invisibilisation du corps d’un « élève-zombie » (p. 13), dont la présence semble se réduire au simple usage de l’oreille et de la main. L’auteure suggère alors « le rétablissement d’une vie relationnelle, corporelle et affective, facilitée par le changement spatial, [pour] favorise[r] la circulation du langage » (p. 51).
Les apports de l’approche cognitiviste, sur lesquels se sont longtemps appuyées les sciences de l’éducation, semblent atteindre leurs limites dans plusieurs domaines de recherche, que ce soient la psychologie, les neurosciences, la philosophie ou la linguistique. De récents courants, comme la cognition incarnée, s’inscrivent dans la continuité des approches phénoménologiques et ouvrent des perspectives éducatives, en replaçant le corps au centre du processus d’apprentissage.
ans le cadre plus spécifique de l’éducation artistique, il s’agira alors de nous demander dans quelle mesure la corporéité des apprenantes et apprenants est engagée lors d’expériences de création dans les disciplines artistiques. Nous proposons d’explorer la place du corps dans l’éducation en art à travers trois grands axes : le corps médiateur (le corps en relation directe à son milieu environnant), le corps médié (le corps aux prismes des technologies numériques et non numériques) et le corps médiatisé (les enjeux d’une éducation artistique à distance).
-

La notion de didactique dans l'enseignement des arts
No. 1 (2023)La thématique de ce premier numéro du Journal de recherche en éducations artistiques - Journal of Research in Arts Education est centrée sur la notion de didactique dans l’enseignement des arts. Cette notion possède des sens, des acceptions et des applications différents selon les pays, les disciplines et les situations d’enseignement-apprentissage. La notion de didactique est pour certain·e·s une mise en œuvre de savoir-faire des enseignant·e·s ou de l’enseignement. Pour d’autres, des formes d’ingénieries de formation, ou encore, un objet de recherche sur les processus d’enseignement-apprentissage. Quelles sont les discours, les discussions et les controverses qui coexistent au niveau international dans les différentes disciplines artistiques ? Sur quel(s) fondement(s) épistémologique(s) et méthodologique(s) s’appuient ces différences ou ces similitudes ? Quels paradigmes traversent cette notion de didactique ?
Dans le domaine de la recherche en didactique, nous avons souhaité confronter les points de vue qui s’intéressent au développement des personnes par l’enseignement ou l’apprentissage en éducation artistique. Nous avons donné la parole à des chercheur·e·s, professeur·e·s ou professeur·e·s associé·e·s, à des forma·trices·teurs et des artistes-enseignant·e·s, pour expliciter les fondements et les caractéristiques de la notion de didactique dans leur discipline.
Dans ce premier numéro JRAE/JREA nous publions sept articles : cinq en français et deux en anglais. Chacun de ces sept articles a été corédigé par au moins deux chercheur·e·s issu·e·s, pour la plupart, de différentes institutions universitaires de formation à l’enseignement des arts d’un même pays ou de différents pays (Allemagne ; Canada ; France ; Suisse ; Irlande) afin d’apporter, à l’international, des regards croisés sur le concept de didactique dans l’enseignement de la musique, des arts plastiques/arts visuels, des arts appliqués/Design, de la danse et du théâtre.
-

Le corps en mouvement dans l’enseignement de la musique et de la danse
No. 2 (2024)Pour ce deuxième numéro JREA/JRAE, nous souhaitons publier des articles sur l’enseignement de la musique et sur l’enseignement de la danse. Il s’agit de s’intéresser aux travaux en didactique et pédagogie de la musique et de la danse en mettant un accent particulier sur la place du mouvement et du geste. Apprentissage musical et mouvement sont intrinsèquement liés notamment dans l’enseignement de la rythmique dalcrozienne (Brice, 2014 ; Croset et Willen, 2015) et dans les pratiques instrumentales collectives ou individuelles (Batézat-Batellier, 2017 ; Guillot, 2011 ; Tortochot et Terrien, 2021). Ces recherches peuvent questionner le rôle des gestes dans la transmission et construction des savoirs comme la place des mouvements corporels dans la didactique de l’apprentissage instrumental (Rickenmann et al., 2019 ; Terrien, 2013, 2022), dans l’enseignement de la musique à l’école (Bremmer, 2015, 2021 ; Moor et al., 2020 ; Nijs et Bremmer, 2019 ; Terrien et Leroy, 2012) et dans l’enseignement aux élèves à besoins particuliers (Bremmer et al., 2021).
Dans l’enseignement de la danse à l’école, l’apprentissage des savoirs s’effectue par le corps en mouvement (Duval et al., 2022) et des études récentes s’intéressent aux pratiques didactiques et pédagogiques des enseignants favorisant la réussite de tous et le développement de chacun des élèves dans une école plus inclusive (Duval et Arnaud-Bestieu, 2021). Dans l’enseignement supérieur, des recherches récentes sur les formations aux métiers de professeur des écoles ou de danse sensibilisent les futurs professionnels à la compréhension et à l’innovation pédagogique et chorégraphique (Arnaud-Bestieu, 2019 ; Simonet, 2019).
Ce numéro vise aussi à collecter des résultats de travaux de recherches en éducation qui croisent ces deux enseignements artistiques, où les tâches emblématiques comme l’improvisation, la composition et le travail sur les formes, peuvent être étudiées (Arnaud-Bestieu et Terrien, 2018 ; Espinassy et Terrien, 2018). Comment le pédagogue conduit-il ces situations d’enseignement-apprentissage ? Comment les réponses des élèves reconfigurent le cours ? Comment créer un environnement pédagogique à la fois ouvert et rétroactif, permettant les apprentissages ?
-

Le design et son enseignement : état des lieux et perspectives
No. 3 (2024)Si les recherches sur l’enseignement du design abondent dans la littérature scientifique anglo-saxonne depuis une cinquantaine d’années, en revanche, l’émergence récente d’une communauté de chercheurs francophones et germanophones doit être signalée. Dans les traces du No 15 spécial de la revue Sciences du design (Dupont et al., 2022), ce troisième numéro de la revue internationale à comité de lecture Journal de recherche en éducations artistiques/Journal of research in arts education (JREA/JRAE) en est un signe fort.
L’appel à publication du numéro 3 JREA/JRAE a pour objectif d’amener les membres de cette communauté à réfléchir sur une discipline de l’« entre-deux » (Petit, 2023) autour de trois axes.
Le premier axe porte sur les recherches en sciences de l’éducation et en histoire de l’éducation artistique : que savons-nous de l’enseignement du design tel qu’il s’est constitué dans son histoire plus ou moins récente et tel qu’il se caractérise aujourd’hui ? En somme, il s’agit de contribuer à une réflexion épistémologique, historique, didactique sur le design et son enseignement, ensemble, pour comprendre ce qui se conçoit aujourd’hui et qui a été enseigné hier, et ce qui s’enseigne aujourd’hui pour concevoir demain (Tortochot, 2023).
Le deuxième axe a pour ambition de montrer l’importance de la recherche sur l’enseignement de la conception pour mieux comprendre les enjeux de l’école de demain (Didier, 2021). Là encore, une démarche épistémologique est sous-jacente : de quoi parlons-nous quand il s’agit d’enseigner la conception ? De quelle conception parlons-nous quand il s’agit d’enseigner le design par le projet ? Pourquoi avons-nous besoin de clarifier ces points, si ce n’est parce que nous avons à répondre à une forte pression sociétale face aux complexités et injonctions technologiques en vue d’un progrès collectif, d’une démocratie technique ?
Le troisième axe offre une possibilité d’ouverture vers la place de l’artefact comme médiateur interagissant avec l’apprenant autonome (Küttel, 2022) pour penser l’enseignement du design. Ce qui est en jeu, c’est l’expérience esthétique du monde et des systèmes complexes qui le constituent. L’individu est acteur-réseau (Latour, 1998) : il crée des réalités dans ce monde, il établit des structures ainsi que des liens dans une situation en évolution.
Les auteurs s'emparent de ces questionnements, qu'ils enrichissent de leurs points de vue pour œuvrer à une recherche collective.